Sacha Najman, lauréat d'un contrat doctoral 2022 à l'EHESS pour sa thèse "Genre, homosexualité et placard dans les bals, les cabarets et les music-halls parisiens d’entre-deux-guerres"
Sacha Najman est lauréat d'un contrat doctoral de l'EHESS pour sa thèse "Genre, homosexualité et placard dans les bals, les cabarets et les music-halls parisiens d’entre-deux-guerres", au sein de la formation Arts et langages et du Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL), et sous la direction d'Esteban Buch. Cette année 2022, l'EHESS a désigné 35 lauréates et lauréats d'un contrat doctoral à l'EHESS.
Qu'avez-vous étudié avant la préparation à votre doctorat ?
Je suis entré en Master à l’EHESS au sein de la mention Arts, littératures et langages suite à trois années de classes préparatoires en spécialité de Lettres modernes. Mon mémoire portait sur les rapports entre musique et politique dans les cercles artistiques et littéraires noirs du Paris d’entre-deux-guerres. L’approche des liens entre musique, subculture et rapports de pouvoir m’a conduit interroger les productions sonores au prisme de leurs ancrages politiques et sociaux.
Pourriez-vous nous raconter votre projet de thèse ?
Le vingtième siècle marque un tournant en Europe dans les représentations des sexualités. Ces dernières ne sont plus comprises à travers un ensemble de pratiques, mais comme des identités incarnées dans ces pratiques. Mon projet vise à examiner l’articulation entre ces nouvelles catégories et la constitution d’un auditoire queer à Paris. Avec l’émergence d’une culture musicale de masse en France, le développement de technologies sonores modernes et l’apparition d’une culture urbaine associée à une liberté sexuelle, un nouveau rapport au son se construit. Les figures issues du vedettariat se positionnent dans une distinction entre hétérosexualité et queerness. Au music-hall, les voix de fausset, les chanteurs de charme et les divas se situent dans cette reformulation des imaginaires. Les musiques populaires façonnent les expériences et les subjectivités gaies et lesbiennes du Paris d’entre-deux-guerres. Penser un rapport queer à la musique et au son permet d’envisager l’homosexualité comme pratique culturelle. Plutôt que de montrer comment la musique s’imprègne des représentations du genre et des sexualités, je cherche à comprendre comment la musique compose les formes produites par le placard (camp, drag, double sens), dont on retrace le fil dans les bals et les cabarets. Sur scène, la présence de figures queer ne repose pas exclusivement sur les relations de pouvoir incarnées dans les représentations des corps et des sexualités, mais s’inscrit dans une définition de la queerness comme catégorie esthétique et politique. La voix n’est plus l’organe qui traduit une sensibilité érotique ou un désir : elle devient le curseur qui permet de se situer dans ou en dehors de l’ordre hétéronormatif.
Pourquoi faire de la recherche et qu'est ce qui vous anime ?
Ce projet s’ancre dans une perspective transversale, à travers l’étude de sources peu abordées dans le cadre d’une histoire culturelle des homosexualités en France. Les objets dont je me saisis invitent à questionner les productions musicales comme les archives queer d’une histoire du son. Penser les productions sonores au prisme du tournant dans les représentations du genre et des sexualités permet un nouveau regard sur des objets dévalués tels que le music hall et engage une réflexion sur la musique depuis le placard. Je souhaite apporter une contribution à la musicologie queer au sein du champ académique francophone, dans lequel ces recherches ne sont pas encore assez rendues visibles. Il s’agit à la fois d’articuler les questions sonores à des objets habituellement pensés en des termes visuels, comme le camp et le drag, et d’intégrer les études queer aux travaux socio historiques portant sur la musique.
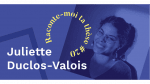
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés


